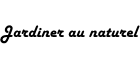Le purin d’absinthe
La trouver
Surtout en montagne, dans les lieux incultes, friches et abondances, sur les murs et sur les rochers secs.
Préparation
Prendre 2,5 Kg de feuilles, fleurs et tiges d’absinthe (Artemisia absinthum), les hacher dans 10 litres d’eau de pluie et laisser tremper pendant 10 jours. Le mélange est ensuite filtré et stocké à l’abri de l’air et de la lumière. Si on utilise des feuilles séchées pour réaliser ce purin, la dose est alors de 300 grammes pour 10 litres d’eau.
Utilisation
Ce purin s’utilise pur contre les pucerons, les chenilles, les altises, les limaces et les escargots.

Attention, Pesticides Danger !
Bientôt, de nombreux champs vont se parer d’une couleur orangée, signe du traitement de la végétation à l’aide d’une spécialité à base de glyphosate.
Est-ce bien nécessaire?
Puis, beaucoup d’abords de maisons particulières, d’allées, de terrasses vont revêtir à leur tour, cette teinte caractéristique. C’est surement pour la facilité!
Pour continuer, plusieurs rues et trottoirs de nos communes et de nos bourgs vont subir à leur tour, les assauts de nombreux produits chimiques pour éradiquer certaines herbes envahissantes. Une belle bourgade est-elle une bourgade stérilisée?
Arrêtons le Massacre !
Ces produits ne sont pas innocents!
Bien que la plupart d’entre eux portent la mention « biodégradables », ils ne sont pas sans risques, que ce soit pour la nature et l’environnement, ou pour notre santé.
Dans le sol et dans l’eau, ceux-ci se transforment, et leurs métabolites continuent leur action de destruction à petit feu. A la longue, ils se retrouvent dans les nappes phréatiques et nous ne tardons pas à les retrouver dans l’eau du robinet.
Comme les désherbants, les insecticides et les fongicides sont aussi des produits toxiques : leur action à long terme peut entraîner de graves problèmes. Les molécules se stockent dans les tissus de tous les composants de la chaîne alimentaire, et, plus celle-ci évolue, plus les concentrations augmentent.
N’oublions quand même pas que l’homme est le dernier maillon de cette chaîne, et, à ce titre, il va concentrer un maximum de produits.
Une enquête récente auprès de députés européens a démontré que plusieurs dizaines de produits dangereux se trouvaient dans leur sang. Pourtant, ces personnes n’ont jamais dû manipuler de tels produits !
Au contraire, les jardiniers amateurs et les employés communaux ne prennent souvent aucune précaution pour manipuler de tels produits. Quand aux doses administrées, elles font plutôt l’œuvre d’un joyeux hasard : pour être efficace, combien n’hésitent pas à forcer la dose ?
Les produits chimiques peuvent pénétrer dans notre corps à travers la peau, à la suite d’un simple contact, et leurs vapeurs vont profiter de notre système respiratoire pour entrer dans les poumons et rejoindre le système sanguin.
De plus, en traitant les légumes du potager, ceux-ci vont garder dans leurs cellules une partie des molécules du produit et, lorsque nous les mangeons, ils pénètrent notre organisme et vont se stocker dans plusieurs de nos organes, d’où ils pourront continuer leur travail de sape.
Il est vrai qu’aujourd’hui, l’apparition de plusieurs maladies est encore inexpliquée. Il y a peut-être là une relation de cause à effet.
Il existe d’autres méthodes pour travailler au jardin sans se faire empoisonner et en respectant la nature.

Le fumier
Elément fertilisant naturel utilisé depuis très longtemps dans nos campagnes, le fumier résulte de la décomposition partielle des litières des animaux d’élevage, mélangées à leurs déjections solides et liquides. Les plus communs sont les fumiers de bovins et de porcs, mais il ne faut surtout pas négliger les fumiers de cheval, de mouton, de volaille et même de lapin.
Contrairement à la plupart des déchets végétaux, un fumier de bonne qualité est riche en cellulose et en lignine, deux molécules organiques difficiles à dégrader. Le fumier se décompose beaucoup plus lentement que les algues et il contient beaucoup d’humus stable ; c’est ce qui explique sa capacité à améliorer la structure d’un sol : en floculant, il permet la constitution de petits agrégats qui vont retenir les minéraux et favoriser la perméabilité à l’air et à l’eau.
Comme les algues, le fumier apporte au sol une quantité d’éléments fertilisants, que ce soit les éléments majeurs (azote, phosphore, potasse) ou des oligo-éléments en quantité non négligeable : suivant la provenance du fumier, ces quantités vont varier quelque peu.
Le plus riche, mais aussi sans doute le plus difficile à trouver, c’est le fumier de cheval : il se fragmente plus facilement que le fumier de bovin et il convient mieux aux terrains lourds et argileux. Il est aussi idéal pour la confection des couches chaudes, en mélange avec des déchets verts pour augmenter la fermentation : l’augmentation de la température permettra ainsi de hâter la production de légumes et de plants de fleurs pour le printemps.
Le fumier de volaille, bien que déséquilibré ( il est très riche en azote et en acide phosphorique), ne doit pas être utilisé directement : il doit subir un compostage avec d’autres déchets végétaux pour être assimilable par les plantes. Sans cette précaution, les racines seront brûlées à son contact et la croissance des plantes sera compromise.
Le fumier de bovin est plus froid que le fumier de cheval, mais il est plus consistant ; plus lourd, il sera à son avantage pour la fertilisation des terres sableuses à qui il donnera du « corps »et il se décomposera plus lentement. Il améliorera aussi sensiblement la capacité de rétention en eau du terrain.
Le fumier de mouton présente des caractéristiques analogues à celui de bovin, il sera plutôt recommandé en terre argileuse tandis que le fumier de porc est plus compact. Le fumier de lapin s’emploiera après un compostage de quelques mois.
Compositions moyennes de différents fumiers (en % de matière fraîche) :
| Type | Matièreorganique | Eau | N | P2O5 | K2O | CaO |
| Cheval | 24-28 | 68-74 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 0,2-0,7 | 0,6-1 |
| Ovins | 23-27 | 60-65 | 0,7-1 | 0,2-0,4 | 0,7-0,9 | 0,6-1 |
| Bovins | 16-20 | 74-80 | 0,3-0,6 | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | 0,6-1 |
| Porcins | 14-20 | 70-77 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,5-0,7 | 0,4-0,8 |
| Volailles | 10-20 | 50-60 | 1,6-2 | 1,5-1,8 | 0,8-1 | 2-2,5 |
La meilleure utilisation des fumiers consiste en un compostage de quelques mois en tas, remué de temps en temps pour activer l’activité biologique, et pour parvenir à l’obtention d’une pâte brune, très riche en humus ; épandu en fin d’hiver, avant d’être incorporé au sol, il sera directement utile aux plantes.
Une autre pratique se rencontre souvent : le fumier est étalé frais sur le sol dès la fin de la culture et il va rester sur le sol pendant plusieurs mois avant d’être enfoui. Dans ces conditions, il va se dégrader lentement et il protègera aussi le sol contre le lessivage du à la pluie et il va développer l’activité biologique du sol en surface, permettant ainsi un échange plus rapide des éléments fertilisants.
Au jardin d’ornement, il peut aussi être employé comme paillage des massifs de vivaces et d’arbustes pendant l’hiver : non seulement, il va apporter des éléments nutritifs utiles aux plantes, mais en plus, il va leur offrir une protection supplémentaire contre les effets du froid : les frileuses apprécieront…
A l’heure d’aujourd’hui, il est devenu bien difficile de se procurer de tels trésors, du moins à l’état frais. On pourra alors se rabattre sur des fumiers déshydratés, compostés, disponibles en sacs dans le commerce. Ils n’apportent en fait que peu d’humus au sol et leur action sur l’amélioration physique des terres légères est pratiquement nulle.

Le lithothamme
C’est une algue marine calcaire (Lithothammium calcareum). Elle est riche en calcium (45%), magnésium (6 à 10%) et en oligo-éléments. Elle s’emploie notamment pour corriger le Ph des sols.
Il s’emploie aussi, dans sa forme micronisée, en fertilisation foliaire des plantes. Il a aussi une action de renforcement de la résistance des plantes face aux maladies, contre les champignons en particulier.
En correction du Ph du sol, le lithothamme s’emploie à la dose de 50 Kgs pour 1000m², avec un épandage à l’automne et un autre au printemps. Il est important de bien fractionner les apports pour ne pas provoquer de blocage au niveau du sol.
Pour la fertilisation du potager, nous ferons un apport annuel au printemps, lors de la préparation du sol, pour compenser les exportations de calcium par les cultures. Le calcium du sol permet aux légumes de mieux résister aux maladies, en particulier celles dues aux champignons. En améliorant aussi le taux de matières sèches, il augmente la durée de conservation hivernale.
De plus, le lithothamme nous permet de ne plus utiliser les produits à base de cuivre, dangereux pour notre santé, notamment dans le traitement du mildiou sur les cultures de pomme de terre et de tomates. Il faut l’utiliser en poudrage léger, au petit matin, lorsque les plantes sont recouvertes de rosée. En se diluant dans l’eau qui recouvre les feuilles, le calcium pénètre dans les cellules au travers des stomates et va ainsi empêcher le champignon parasite de s’installer. Ce poudrage devra être répété tous les 10 jours, en fonction des conditions climatiques.
Pour les arbres fruitiers, nous ferons également un apport de lithothamme en fin d’hiver. Cela permettra aussi aux arbres de mieux résister aux maladies cryptogamiques et cela améliorera la qualité gustative des fruits. Autre effet non négligeable, cet apport permet de diminuer le développement du lichen sur le tronc et les branches de l’arbre. On peut aussi effectuer un poudrage de l’arbre en cours de végétation lorsque celui-ci est humide ; cela limitera en plus le développement des pucerons.
Autre application non négligeable, le traitement de la mousse dans le gazon : en réalisant deux épandages de lithothamme, au printemps et à l’automne, on arrive à diminuer le développement de celle-ci. Le lithothamme agit de plusieurs façons : il aura une influence très positive sur la floculation de l’argile, ce qui va améliorer le drainage du terrain et diminuer le taux d’humidité de celui-ci. En renforçant le taux de calcium du sol, les mousses ont plus de difficultés pour s’installer et finissent par disparaître.
Nous utilisons aussi le lithothamme dans la fabrication des différents purins ou macérations : en apportant une poignée de poudre dans un seau de 10 litres, nous renforçons l’action du purin sur les plantes par un apport supplémentaire de calcium et surtout, nous supprimons le désagrément principal de ces fabrications, l’odeur parfois nauséabonde.

La luzerne
C’est une légumineuse à fleurs violettes, très résistante à la sécheresse. Ceci est du à la profondeur de son système racinaire, qui n’a pas son pareil pour ameublir le sol en profondeur ; pour cela, il vaut mieux la laisser en place pour une période de deux à trois ans. C’est l’engrais vert idéal pour les sols calcaires. Elle demande à être semée au printemps à la dose de 200 grammes pour 100 m².

Le purin de consoude
Préparation
Utiliser 700 grammes de consoude de Russie (Symphytum peregrinum), les hacher dans 10 litres d’eau de pluie, fermer hermétiquement le récipient en plastique et laisser macérer pendant 30 jours. Filtrer ensuite ce mélange et le stocker.

Utilisation
Le purin de consoude s’emploie pur : c’est un activateur de croissance pour de nombreux légumes, et en particulier pour les légumes-fruits: tomate, concombre, courgette.
Il est riche en azote et en potassium; les feuilles de consoude peuvent aussi rentrer dans la composition du compost.